29 juillet 2014
Lueurs de Bombay
©Paolo Pellegrin, Bombay, The waterfront, 2005
Ville-archipel se lovant le long du sous-continent telle une pince de crabe, Bombay est la porte des Indes ; son cœur foisonnant. Quatre auteurs : Giorgio Manganelli, Sadegh Hedayat, Lorenzo Pestelli et Arun Kolatkar – nous aurions pu en choisir bien d’autres – pour découvrir cette mégapole.
Ecrivain, et journaliste traducteur de T.S Eliot et d’Edgar Alan Poe en italien, Giorgio Manganelli (1922-1990) est envoyé en Inde en 1975 pour la revue Il Mondo. Celui qui écrivait que la tâche de la littérature était de transformer « la vérité en mensonge, en scandale et en mystification » trouve un terrain de jeu inimitable sur les terres indiennes – « ce réservoir à merveilles ». Le texte proposé est le début du troisième chapitre d’Itinéraire indien et décrit les premières sensations du narrateur à son arrivée à Bombay.
La porte de l’avion – la maison volante et protectrice est dotée d’une porte – s’ouvre lentement. Dehors, à cinq heures du matin, il fait encore nuit, les projecteurs habituels évoquent un film de gangsters ; l’air qui envahit la passerelle m’annonce que je suis ailleurs, Je connais cet air, je le renifle et il me renifle ; c’est l’air des tropiques, humide, doux, réchauffé par la macération des herbes, des animaux, des égouts à l’air libre, aigri par un relent d’urine, de bêtes en captivité ; c’est un air qui m’émeut, m’excite par sa décomposition et son ingénuité, sa lourdeur génératrice de champignons, de moisissures, de mousses ; voilà l’air de l’Inde, sale et vital, purulent et douceâtre, putréfié et infantile. On peut jouer avec cet air, mourir dans cet air, quoi qu’il en soit, il est envahissant, il compte les doigts de vos mains, vous touche la nuque, vous caresse comme la langue d’un animal à peine sorti des bois, plus curieux que gourmand. On a l’impression de plonger dans un marais d’air. L’Europe disparaît derrière moi, tout comme le très propre Siddartha ; et même le vedânta expliqué par Aldous Huxley paraît un fantasme hygiénique. Je suis en Inde, au seuil d’une maladie continentale, d’un lieu dont la première bouffée d’air me parle de décomposition et d’immortalité, de lèpre et d’idoles. Dans l’intervalle de temps nécessaire aux formalités succinctes des douanes de Bombay – je suis fier de déclarer que « je n’ai pas d’appareil photo » -, la nuit remonte son rideau, se débarrasse de ses étoiles et cède la place à une aube un peu écourtée, puis à une aurore pressée et enfin à un jour éclatant. Je suis assailli par des porteurs maigres, filiformes, et quelqu’un me persuade de prendre un billet d’autobus. Il s’agit d’un véhicule hautement improbable, vide, rongé par l’atmosphère. On me dit dans un anglais horrible que d’autres clients attendent, et pourtant l’autobus reste désert. Il songe à la mort, aux poignées qui lui manquent, aux lumières qui ne s’allument plus, aux courtes pales des ventilateurs qui s’agitent tels les cils d’une vieille séductrice. Pendant ce temps, de grands oiseaux un peu fastueux, selon toute probabilité des vautours officiels, tournoient au-dessus de l’esplanade de l’aéroport en poussant des cris qui cachent un grand appétit, de lugubres conversations ; ils m’observent avec intérêt, vaguement complaisants. Dans toute autre partie du monde, cette attente dans un car désert et délabré, protégé par le vol en croix des vautours, se révélerait tout à fait sinistre, mais là, à Bombay, en ce lieu si dense d’images terrestres, inhabituelles, elle est étrangement excitante, comme si j’avais atterri sur une planète aux lumières inconnues et impossibles. Personne ne monte dans le car, qui peut ainsi poursuivre ses méditations oxydées ; un adolescent taciturne me rend l’argent de mon billet et je suis transféré dans un taxi. Celui-ci non plus d’une santé florissante, il est ridé, édenté, émaillé de trous, comme si les vautours l’avaient picoré ; cependant, son chauffeur me promet de m’amener à Bombay, non sans émettre quelques doutes sur l’existence de la ville, ce qui traduit moins du pessimisme qu’une sagesse troublée par les maladies tropicales. Entrer dans Bombay par la route de l’aéroport donne l’impression de faire connaissance avec un grand corps en y pénétrant par ses sphincters ; il est en effet indubitable que le long itinéraire qui m’amène au centre de Bombay, centre qui se trouve en périphérie, n’est pas sans rapport avec l’anus et les parties génitales de la ville. On passe à travers une double ou triple rangée de masures faites de tôles, de bouts de bois, de tissu ; ce ne sont cependant pas véritablement des masures : plutôt des taudis mobiles, des tanières nomades. Sur une série de ces perchoirs, quelqu’un a peint avec un humour surprenant de joyeuses scènes religieuses. Mon taxi, ignoré de tous, traverse ces lieux humains comme un mur fait de patience séculaire : d’une patience blessée, mais non humiliée. L’impression que suscitent ces masures minuscules, sales, infectes, chancelant entre ruisseaux et immondices, est étrangement libératrice : ici, aucune tentative de voiler, de cacher, d’éluder ; la saleté fondamentale de l’existence, sa qualité excrémentielle et trouble est vécue avec placidité. Je viens d’un pays aux cabinets éclatants et je me retrouve propulsé au cœur d’un monde qui n’a pas peur d’exhiber ses excréments. Cet univers – je le découvre à présent et une fois pour toutes – n’est pas sale par accident : il l’est de manière essentielle, constante, placide. Mais cette saleté n’est pas la nôtre, ni le reflet d’une civilisation qui a enfermé ses propres déjections dans des cages de céramique immaculées ; c’est la saleté originelle, celle de l’aube des temps, celle que nous avons trahie, comme nous l’avons fait de tout notre corps, nos poils, notre sueur, nos ongles, nos parties génitales, nos sphincters. Gloire aux sphincters : je poursuis ma route parmi un monde anonyme, mortel et létal, mais qui n’a pas commencé à s’effrayer de l’intégralité heureusement immonde de son propre corps. Etrange sensation où domine une sorte de félicité étourdie, grossière, même si j’ai le sentiment de n’être pas digne d’un monde si superbement envahi de sa propre matérialité. Quelques vaches maigres et errantes que les taxis évitent avec précaution traînent dans les rues, et je les perçois comme des édicules maladroits mais sacrés que l’on rencontre à la campagne ou aux coins des ruelles de Rome ou de Naples. Émaciées mais placides, légèrement irréelles, les vaches confèrent à la forêt humaine une lenteur pieuse, une délicatesse indolente et mystérieuse.
Giorgio Manganelli, Itinéraire indien, traduit de l’italien par Christian Paolini, Paris, Le promeneur, 1994.
Lunatique est l’une des rares nouvelles que Sadegh Hedayat (1903-1951) ait écrite directement en français. En 1936, Hedayat s’est rendu à Bombay afin d’y parfaire son pehlevi au sein de la puissante communauté parsie de Bombay. Ce séjour en Inde le marquera profondément et surtout c’est là-bas qu’il écrira son récit le plus célèbre La chouette aveugle (ici dans une traduction anglaise). Il se suicidera à Paris en 1951, depuis son influence n’a cessé de croître dépassant les frontières de l’Iran pour être cité par des auteurs du monde entier comme source d’inspiration et d’admiration.
Cette nouvelle est disponible dans le recueil L’eau de jouvence. La nouvelle éponyme est offerte en intégralité sur le site des éditions José Corti, ici.
Une pluie torrentielle fouettait le sol sans défense, une pluie pareille à celle des premiers âges de la Terre. Le vent chassait sur la route asphaltée une fine poussière de particules d’eau, tandis que la mer, silencieuse et passive, pleine de ses profondes et lointaines amours, était plongée dans une brume de plomb. Tout était suintant, gluant, visqueux; l’humidité rongeait et attaquait tout, pénétrant le corps et alourdissant l’âme. Un frisson de désir parcourait les êtres, un souffle de folie ou d’ivresse invitait à l’oubli, à la lassitude; le désir fou de tout abandonner, jusqu’à son propre corps, s’éveillait d’on ne sait quelbas-fond de l’être. Dans cette lascivité passionnée, l’eau s’écoulait, l’eau furieuse de quelque dieu en colère. La pluie étouffait les bruits extérieurs et s’arrêtait brusquement.Dans la chambre, au rez-de-chaussée de ma nouvelle pension, toute confortable qu’elle parût, je ne pouvais pas encore m’habituer aux objets environnants : les meubles offraient une expression bizarre, énigmatique, tels des êtres vivants. La commode sérieuse et trapue, la haute armoire étroite à l’air pratique, mais dur et moqueur, la brave table ronde, le miroir coquet, tous me surveillaient avec une vigilance menaçante. Il flottait dans l’air une odeur âcre et poivrée, qui ne se rencontre qu’aux Indes. Un vieux cordonnier indien, demi-nu, coiffé d’un turban rouge, s’était abrité sous le linteau de ma fenêtre en une pose hiératique et résignée, et contemplait le déchaînement des éléments. Desséché, presque décharné, il avait le teint couleur olive, des yeux noirs enfoncés dans leurs orbites et une barbe mal taillée qui lui mangeait le visage. Devant lui traînant une vieille boîte et des chaussures usagées.Durant toute l’après-midi, je m’acharnai sur mon phono : j’étais obsédé par un disque indien que j’avais acheté au hasard, et je le passais et le repassais sans interruption. Installé dans le fauteuil, je regardais la pluie et les rares passants qui s’aventuraient au dehors. Ma fenêtre donnait sur la mer, masse grise et paresseuse qui se confondait avec l’horizon brumeux.Soudain, quelqu’un frappa à ma porte. J’ouvris et apparut alors une femme mince, à la figure pâle, aux traits réguliers. Sur son front se dessinait le léger réseau de ses veines, elle avait de grands yeux verts, très clairs, et des cheveux paille. Elle prit un air distrait pour me dire : « Je suis excédée, ça me tape sur les nerfs, pour l’amour du ciel, arrêter ce disque ! »« I’m so sorry », répondis-je.Elle me remercia et s’en retourna dans la chambre voisine.J’arrêtai mon phono, pensant qu’elle était une étrangère encore peu habituée à la musique indienne, ou la détestant, par simple préjugé. Je m’étendis sur mon lit et parcouru une revue locale illustrée.A huit heures, je montai au troisième étage, là où se trouvait la salle à manger. Le patron, un métis originaire de Goa qui se disait Portugais, me présenta à une demi-douzaine de personnes appartenant à des nationalités douteuses. La soupe était déjà servie quand la porte s’ouvrit avec fracas devant ma voisine, qui faisait une entrée remarquée. Elle portait une robe crêpe imprimée, à fleurs bleues et jaunes, très longue, décolletée, bien serrée à la taille, et se déplaçait avec une élégance naturelle qui rehaussait sa beauté et ajoutait à sa silhouette élancée une gaité champêtre. Elle salua les pensionnaires d’un signe de tête et s’assit sur la seule chaise vacante qui restait à notre table.Le souper terminé, je demandai au patron qui était cette femme. (…)
Sadegh Hedayat, L’Eau de Jouvence et autres récits, traduit du persan par M.F et Frédéric Farzaneh, Paris, José Corti, 1996.
Le long été de Lorenzo Pestelli (1935-1977), c’est un récit-fleuve de voyage construit comme une journée de huit heures scandée par les animaux du zodiaque chinois. Chaque heure correspondant à plusieurs pays traversés lors de pérégrinations (souvent mélancoliques) de quatre années à travers l’Asie (1964-1968). Dans cette œuvre magistrale, Lorenzo Pestelli joue avec un foisonnement de formes littéraires : poésie, piécettes, notes de voyages etc…. D’une incroyable poésie et originalité, Le long été n’oublie pas d’être aussi une critique dure sur la mondialisation (les américains sont au Vietnam). Lorenzo Pestelli mourra au Maroc en 1977 dans un accident de la route. Proche de Nicolas Bouvier et de Jil Silberstein, ceux-ci seront les acteurs de la réédition du Long Eté en 2000 aux éditions Zoé.
RAGA DU SOIR
Le ciel a une couleur déchéance… ! Voilà de quoi introduire le poème ! Moins de dix notes exprimées sur un ton mélancolique qui s’acheminent vers un horizon de palabres et de geignements pendant que la mélodie arrache-cœur du shenaï s’inscrit en marge de la feuille de papier dans le trop-plein de la fonderie…
Le ciel couleur déchéance… !
Qui faut-il consulter à l’heure de l’araignée qui s’agrandit dans l’hémisphère boréal ?
Qui nous aidera à tuer ces rats qui, du four de la terre, s’échappent en pleine rue et s’acharnent à disputer la pleine assiette aux cancrelats ?
Nous voulons survivre : hommes et bêtes, sucer aux mamelles de la péninsule qui tombent en chartre, exténués par toutes ces créatures, mammifères et amphibies qui, à l’heure du repas, se présentent chez la doctoresse pour mendier leur dû de riz et de farine !
Le ciel couleur déchéance… ! A qui la faute ?J’interroge la main innocente, je me perds dans un tas d’inepties. S’agit-il d’une déchéance oblique ?
A maints endroits se brise le fil du poème… Il m’est impossible d’en faire un entier avec les débris du désespoir… !
Bombay, juin 1967
Notes de voyage
Je tombe sur une maxime tirée des Upanishads : « Thou hast a right to action, but only to action, never to its fruits. » Est-ce marxiste ou bien le contraire ?
L’Asie se dilue sous le coucher occidental.
Bombay. La mousson du sud-ouest est déjà dans le pays du Mahârâchtra. Nous moisissons dans la mousson en attendant un départ. Lequel ? Tout ce que je touche est moisi. Nous n’avons même pas le temps de nous sécher. Pendant ces affreuses journées de Bombay (on attend que Suez soit réouvert !), on ne parvient même pas à se laver. On loge dans un vieux studio cinématographique des années 1910 qui appartient à un producteur parsi. Chaque nuit, nous faisons campagne contre les rats qui attaquent nos provisions. Chaque soir, les magnats du cinéma de Bombay viennent jouer au poker autour d’une table qui se trouve dans notre chambre.
Les gosses s’esclaffent en voyant l’argent qui se promène sur le tapis vert, ce qui donne une touche tout à fait comique à ce décor austère.
Il ne cesse de pleuvoir.
Les rats, les pies, tout le monde essaye de nous voler ! Toute une population paresseuse et parasite qui se maintient en vie par petits larcins et qui n’a pas de sens moral. De sorte que l’on pourra en vain suspendre un sac au chambranle de la porte ou l’attacher au plafond ; les rats sauront bien grimper, sauter, creuser avec leurs petites dents un chemin jusqu’au riz et à la farine qui constituent notre seule richesse, et dévorer ce qu’il faut pour justifier à leurs yeux tant d’heures de sièges et de tenaces cogitations.
On voit aussi, en plein Bombay, dans le centre des affaires, près de la fontaine de Flora, un rat écrasé et sanguinolent, dévoré par les pies… L’Inde, c’est cela et personne ne s’en soucie. Les rapports entre les castes, entre les hommes sont du même genre. Les riches s’entendent pour égorger les pauvres que l’on retrouve à terre, quelque part, un dimanche matin, et personne n’en a cure… !
Il y a autant d’Indes différentes que de portraits à faire : la paysanne mahârâchtri que je croise au passage à niveau près de Grant Road, l’étudiant malicieux et rempli de questions, le riche businessman à qui j’ai manqué casser la gueule, hier, après avoir évité de justesse son auto. Je lui ai montré une tête si grimaçante qu’il a eu peur ! Entre eux et nous, maintenant, la guerre est certaine !
Qu’est-ce qui nous attend en Europe ? Peut-être la même chose ! Les dalles de la misère seront dures, si je dois en juger par mes propres souvenirs !
Lorenzo Pestelli, Le long été, Carouge, Zoé, 2000
« Plus on nettoie Bombay / Plus il y a de Bombay à nettoyer » écrivait le poète Arun Kolatar (1932-2004). A partir du café Wayside Inn, Arun Kolatkar observait le théâtre de la rue ; des habitants aux animaux, des plantes aux insectes et composait ses poèmes. Le monde de Bombay dans un petit bout d’herbe whitmanien. Dix ans après sa mort, les éditions Gallimard ont fait traduire l’un des cinq recueils qu’il fit paraître quelque temps avant sa mort : Kala Ghoda. Pour un approfondissement de ce passionnant poète, nous vous recommandons la lecture de la préface de Laetitia Zecchini.
The Boomtown Lepers’ band
Trrrap a boom chaka shh chaka boom tap
Ladies and gentlemen (crash),here come (bang), here comes (boom) here comes the Boomtown Lepers’ Band, drumsticks and maracas tied to their hands bandaged in silk and the finest of gauze, and clutching tambourines in scaly paws.
Trrrap a boom chaka shh chaka boom tap
Whack. Let the city see its lion facein the flaky mirror of our flesh.Slap a tambourine (thwack),let cymbals clash.Come on, let the coins shake rattle and rollin our battered aluminium bowl -as our noseless singerlets out a half-hearted howlto belt out a tuneless songfor a city without soul.
Here we come (bang)and there we go (boom)pushing the singer in a wheelbarrow.
Trrrap a boom chakashh chaka boom tapTrrrap a boom chakashh chaka boom tap
Bombay Lepers’ band
Tchac-a-boum-tchac-tchacTchac-a-bim-boum-bam
Mesdames et messieurs (bing)et voici (bang) et voilà (boum)la fanfare des lépreux dans la ville qui fait boum,baguettes et maracas ficelées aux mainspansées de soie et de gaze délicate,pattes écailleuses agrippées aux tambourins.
Tchac-a-boum-tchac-tchacTchac-a-bim-boum-bam
Vlan.Que la ville mire sa face de liondans le miroir piqué de notre peau.Frappez les tambourins (pan),faites claquer les cymbales.Que les pièces roulent, sonnent et trébuchentdans notre bol en alu cabossélorsque notre chanteur sans nezpousse une goualante sans y croireen braillant un air discordantpour une ville sans âme.
On s’en vient (bang)et on s’en va (boum),en roulant le soliste dans sa brouette.
Tchac-a-boum-tchac-tchacTchac-a-bim-boum-bamTchac-a-boum-tchac-tchacTchac-a-bim-boum-zoom
SONG OF RUBBISH
Grapesas vineyard wenches crush them underfoot,aspire to greater glory
after more penance, and a period of silence and seclusionin a dark cellar
Clay,as a potter treads it, hopes to rise again,find a new purpose
and sit,cheek, on a pretty maiden’s shoulder,after being tested in fire
We toohave our own tryst with destiny, and feelthe birth-pangs of a new city,but prepare for a long period of exile in the wilderness of landfill
site.
CANTIQUES DES ORDURES
Les raisins, lors que les filles des vignes les foulent de leurs pieds,aspirent à plus grande gloire
après pénitence prolongée,temps de silence et de réclusiondans un obscur cellier
L’argile,lors qu’un potier la pétrit, espère renaître,trouver nouvelle raison d’être
et trôner,joue contre joue, sur l’épaule d’une joliedamoiselleaprès l’épreuve de feu.
Nous aussiavons pris rendez-vous avec le destin, et éprouvonsles douleurs d’enfantement d’une nouvellecitémais nous préparons à un long temps d’exil dans le désert d’une
décharge.
Arun Kolatkar, Kala Ghoda. Poèmes de Bombay, traduit de l’anglais (Inde) par Pascal Aquien et Laetitia Zecchini, Paris, Gallimard, 2014.






























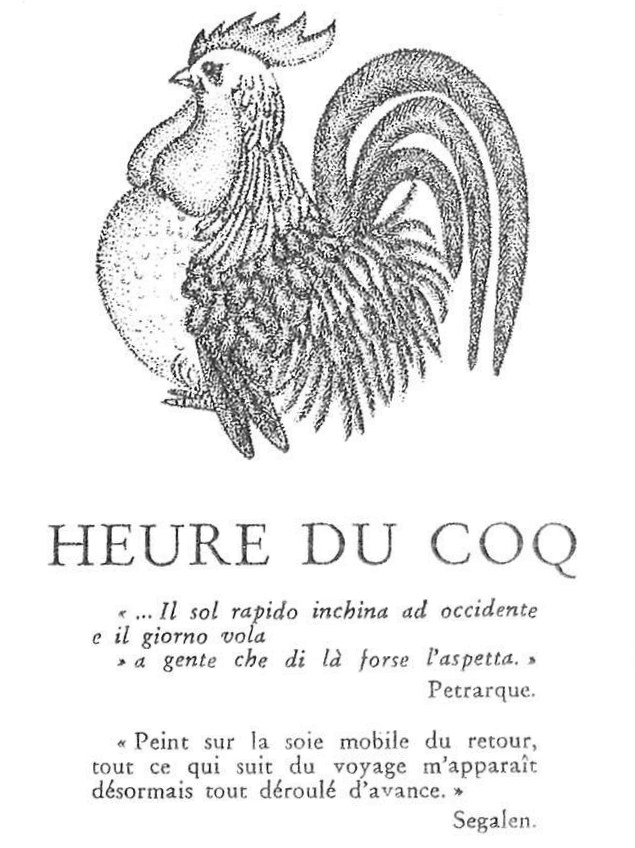
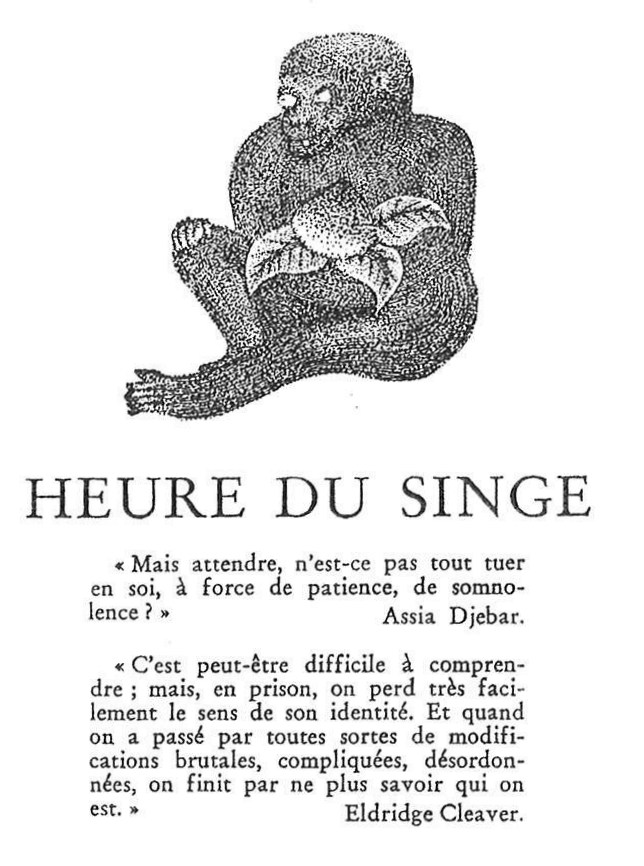

Commentaires